Un vieux métier d’avenir
Un peu d’histoire…
Le métier d’écrivain public n’est peut-être pas le plus vieux métier du monde… mais son origine remonte néanmoins à l’Égypte ancienne, en la personne du « scribe ».
Aussi étrange que cela puisse nous paraître, les pharaons de cette époque ne savaient en effet ni lire ni écrire. C’est donc le scribe qui est chargé de rédiger les registres d’entrées et sorties des aliments dans les greniers à blé et qui légalise par contrats tous les échanges possibles. Par ses connaissances de la lecture et de l’écriture, il tient donc une place de premier ordre dans la société.
Les scribes sont souvent fils de scribe et transmettent leur savoir à leur fils. Dès l’âge de cinq ans, l’élève apprend les signes ; son apprentissage, long et pénible, dure une dizaine d’années. S’il travaille en priorité pour la population pharaonique, il met son talent au service de tous et se trouve ainsi très proche du peuple. Muni de sa palette où sont rangés calames et encriers, il écrit toutes sortes de documents sur le papyrus.
Au Moyen Âge, le papyrus est toujours utilisé puis le parchemin. Muni d’un stylet d’os ou de métal, le scribe écrit sur des planchettes de cire. Couteaux, éponge, pierre ponce et plume d’oie complètent son équipement. Dans les monastères, il travaille avec d’autres (enlumineurs, doreurs, correcteurs, relieurs) pour copier des ouvrages. Animé par la foi, le scribe ne s’intéresse pas au contenu du livre ; toute son énergie et sa concentration sont orientées vers la réalisation de l’ouvrage.
À l’époque de Charlemagne, lui-même illettré, d’importantes réformes sont menées pour améliorer l’éducation qui se limite cependant aux clercs et aux nobles, le peuple paysan en étant exclu. Tandis que le latin demeure la langue d’une élite cléricale, intellectuelle et politique, le français connaît un développement important.
Après la Révolution de 1789, l’enseignement se développe et l’écrivain public perd un peu de son prestige sans toutefois complètement disparaître. Les gens du peuple ont toujours besoin de ses services.
Avec l’école obligatoire jusqu’à l’âge de seize ans puis l’arrivée de l’outil informatique de plus en plus performant et accessible à tous, on a pu craindre que le métier d’écrivain public s’éteigne. Il n’en est rien. Il s’est tout simplement modifié, adapté aux technologies modernes et besoins de ses contemporains.
Muni d’un téléphone portable, d’un ordinateur portable et d’un dictaphone, il reçoit ses clients ou se rend à leur domicile. Sa mission ? Écrire des courriers bien sûr, mais aussi des poèmes, des récits divers, des discours et même des biographies.
L’écrivain public du XXIe siècle
L’écrivain public d’aujourd’hui est souvent un professionnel libéral soumis à toutes les charges et impôts de cette catégorie. Depuis peu, il peut aussi déclarer son activité en auto-entrepreneur. Disposant d’un local ou travaillant chez soi, il peut recevoir ou se déplacer au domicile de ses clients.
Contrairement à la logique, l’allongement des études ne garantit pas aux différents diplômés des écoles une aptitude à se sentir à l’aise dans la rédaction de courriers et autres textes littéraires ou non. Et les correcteurs d’orthographe et grammaire dont sont équipés tous les ordinateurs sont de piètres outils pour qui ne maîtrise pas les subtilités de la langue française.
Il n’est donc pas rare de voir des hommes et des femmes dotés d’un bac plus un nombre impressionnant d’années d’études avoir recours à l’écrivain public pour écrire un article, corriger une thèse ou rédiger un discours. Pour le client, le professionnel de l’écrit a sur la secrétaire ou l’épouse de l’intéressé l’avantage de demeurer complètement dans l’ombre puisqu’il ne se montre jamais aux côtés du client et ne signe jamais (sauf sur demande du client) ce qu’il écrit : le poème, le discours ou la biographie, par exemple, après paiement de la facture, restent la propriété exclusive du donneur d’ordres. L’écrivain public a de plus un devoir de discrétion voire de confidentialité : le secret professionnel.
Comme tous les métiers, celui d’écrivain public, riche en possibilités d’expression, tend à s’organiser en plusieurs spécialités. Certains exercent leur art dans les domaines administratifs et sociaux tandis que d’autres se tournent plutôt vers le rédactionnel ou le secrétariat indépendant.
ZAZ-ECRITOIRE
À mon compte depuis 2004, je travaille pour des professionnels et des particuliers.
Chirurgiens et médecins ont recours à mes services pour saisir leurs courriers lorsque la secrétaire en place, en maladie ou congés, leur fait défaut, ou en supplément en cas de surcroît temporaire d’activité. Des artisans m’appellent pour effectuer les travaux de secrétariat qu’ils n’ont pas le temps de faire eux-mêmes et qui ne peuvent faire l’objet d’une embauche à temps plein ni même à mi-temps. Une association me demande de faire un publipostage, la saisie et la mise à jour d’un fichier. Un éditeur me confie la correction des articles qui composent son magazine. Une mairie me sollicite pour transcrire les fichiers audio de ses conseils municipaux et rédiger les procès-verbaux. Un comité d’entreprise me demande de transcrire leurs réunions mensuelles, en verbatim ou non. Un chef d’entreprise me sollicite pour la rédaction d’un discours, par exemple à l’occasion du départ en retraite d’un salarié.
Des particuliers prennent contact avec moi pour composer un poème pour célébrer un mariage, un baptême, un anniversaire, des obsèques. D’autres ressentent le besoin de mettre des mots sur leur souffrance suite à un décès, un divorce, une longue maladie, un accident. Ils me racontent leur expérience et, grâce au dictaphone discret, je rédige chez moi un texte fidèle au récit. Et puis, la grande tendance, les romans de la vie.
À une époque où l’on parle de familles éclatées et recomposées, à l’ère de la communication intercontinentale spontanée qui tue la communication entre voisins de palier, mes client(e)s éprouvent le désir de laisser un témoignage à leurs descendants. Alors que la tradition orale s’est peu à peu perdue avec l’avènement de la télévision qui règne en maître dans les foyers, l’écrit prend à nouveau la relève. Les personnes âgées racontent l’histoire de leur famille pour que les générations futures sachent d’où elles viennent. La demande émane d’ailleurs parfois des plus jeunes ; il n’est pas rare que des « enfants » se mettent ensemble pour offrir ce cadeau insolite à leurs parents : le roman de leur vie. Feuilles réunies par une simple baguette ou livre imprimé et relié par un professionnel, l’ouvrage s’inscrit ainsi dans la mémoire familiale.
Le métier d’écrivain, tellement varié et passionnant, a de l’avenir !
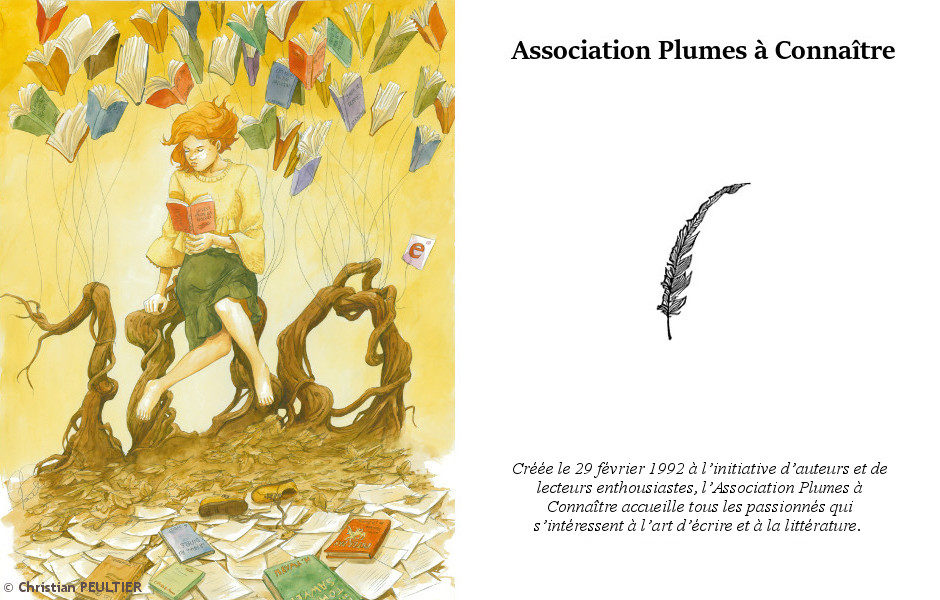
 Portrait de George Sand 1838
Portrait de George Sand 1838 