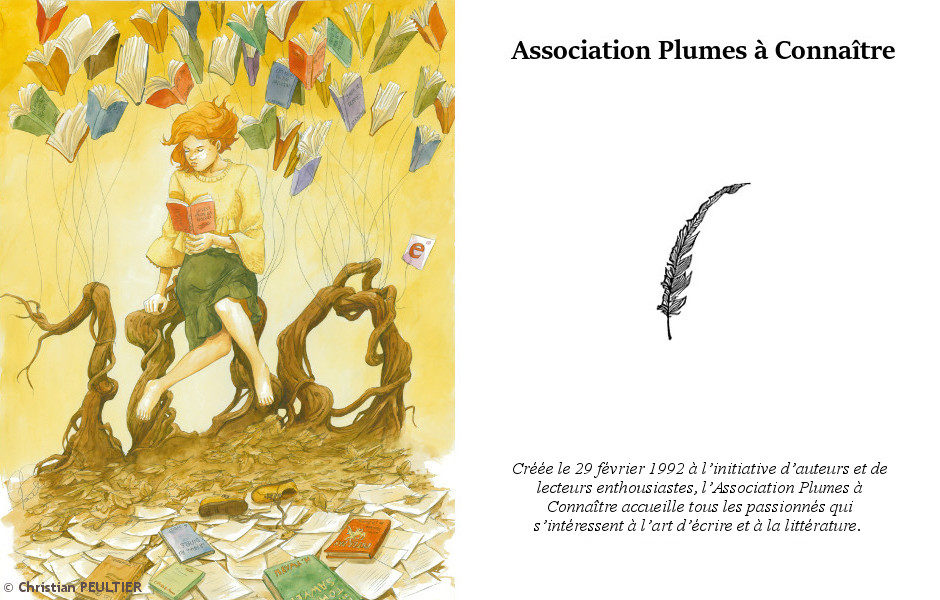Couleurs de la nuit
Encore un cauchemar. Le cœur battant, je reste sur le dos, à reprendre mon souffle. Encore une dispute, à propos d’un rien, d’un désaccord minime, qui nous a entraînés sur la pente inexorable de l’exagération, de l’erreur d’interprétation, de l’incompréhension. C’est la seule façon pour moi de te voir encore, de te parler, alors même si mes rêves de toi sont loin d’être roses, je les attends avec trépidation.
Ma moitié ronfle et grince des dents, sur l’autre oreiller. Moitié. Quelle drôle d’expression. Comme si sans elle, je n’étais pas moi. Comme si je ne pouvais me couper qu’en deux, et au milieu.
Laissant là ce qui devrait pourtant faire contrepoids, je parviens à me lever sans un bruit. Pieds nus, je rejoins mon studio et allume une lampe minuscule qui projette une faible lumière jaune au plafond.
Il me faut une toile carrée, d’une cinquantaine de centimètres de côté. Pas besoin de plus. Je prépare ma palette et m’empare d’une brosse large. Noir, du noir pour l’objet de mon cauchemar. En couche épaisse, en trois dimensions, je l’étale sur la toile, en spirales, en flèches, en formes géométriques tourmentées mais toujours reliées en leur centre, telle l’âme que je cherche à représenter.
Ne plus te voir, ne plus même te parler me laisse un trop-plein de questions, d’angoisses, de mystères de l’âme humaine que je ne peux résoudre par moi-même. Le résultat en est ce tourbillon noir, encore gluant d’appréhension, qui domine ma toile blanche. Mais tu n’es pas le seul à me donner des insomnies.
Mes émotions échappent à tout contrôle. Je dois exorciser mes peurs, me défouler sur la toile plutôt que de tout garder à l’intérieur, au risque d’exploser de manière plus dangereuse. Je porte en moi une inquiétude permanente pour mes proches, une terreur de ce que l’avenir leur réserve. Si je le pouvais, je les regrouperais tous dans un habitat contrôlé, où je pourrais veiller sur eux, pour l’éternité.
Un grognement de dérision m’échappe à cette idée. C’est comme cela que la folie naît et prend racine. Mieux vaut confier mon esprit à la peinture, un substitut inoffensif.
La famille, donc. Dans ce coin en bas, une tache orange en coquillage pour ma tante, engagée dans un combat bien plus horrifiant que le mien, dans lequel mon impuissance me fait enrager. Pour mes frères, qui construisent le monde autour d’eux plutôt que de le regarder défiler sans le comprendre, des zigzags verts. Pour mes parents, des silhouettes violettes, diffuses entre les flèches noires de mon premier dessin, se tournent le dos, regardant chacun vers l’extérieur.
Un ami qui n’a pas le temps devient une sorte de point d’interrogation gris, un autre qui répond parfois est un torrent de pigment bleu. Ne pas savoir comment ils vont, ce qui se passe dans leur vie, s’ils souffrent, s’ils ont besoin de quelqu’un mais ne pensent pas à moi… Mon pinceau vomit cette frustration et la modèle, lui donne forme, construit une image à partir des impulsions qui noient mon cerveau.
Après la famille, après les amis, viennent les plus qu’amis. Le premier est déjà là, servant de trame à toute la composition. Ne pas savoir, ne pas savoir même si tu es encore en vie ou si tu as succombé à l’attrait du noir…
Léger, le poète rafraîchit l’ensemble, son joli nuage jaune apportant une note gaie, dans le coin, tout en haut. Lui aussi a ses tourments mais nous progressons, nous parvenons à avancer, ensemble, peu souvent mais de quelques pas à chaque fois.
Une balafre rouge pour celui dont le contact me brûle, dont les malheurs me plongent en
enfer. Ses flammes menacent d’engouffrer tout le reste. S’il me laissait faire, s’il me donnait un peu de pouvoir, je pourrais le soulager mais il me condamne à me ronger les sangs, au loin.
Pour le petit dernier, je choisis un turquoise lumineux comme son âme brillante et l’applique en bandes fines, actives, alternant courbes gracieuses et lignes droites fulgurantes. Lui me fait avancer à ce rythme, me révèle des mondes fantastiques et m’en donne l’accès depuis ma propre conscience. Lui cherche à me comprendre et à soulager les maux qui me rongent.
Le pinceau me tombe de la main. Je titube jusqu’à la banquette, me roule dans une couverture, contemplant entre mes paupières mi-closes l’œuvre de mon cerveau enfiévré. Art abstrait, dit-on. Il n’y a que moi qui y vois mes attachements et mes souffrances, dans toute leur force, dans leur multiplicité incompatible avec nos convenances mais juste ce qu’il faut pour me remplir et me faire vivre.
Le lendemain matin, ma moitié, encore engourdie de sommeil, découvre la toile, posée sur une chaise de la salle à manger, comme invitée au petit déjeuner. Ma moitié, le phare qui me guide sans jamais chercher à m’ancrer, sans me priver d’une parcelle de liberté, baille et se frotte les yeux. Une tasse de thé à la main, j’attends sa réaction.
« Nuit difficile ? dit-elle en se plaçant dos à la lumière pour mieux contempler les couches de couleurs superposées.
— Productive », commenté-je sans desserrer les dents. Mes démons sont les miens. Les écraser sur une toile, en teinter les fibres de leur jus, oui, mais leur donner vie par la parole, pas question.
Ma moitié reste figée devant le carré bariolé. Au final, le noir équilibre les autres couleurs et les distribue aux quatre coins de l’espace.
« J’aime bien, commente ma moitié avec son laconisme habituel pour mes productions artistiques. Mais on ne le met pas dans notre chambre. Il m’empêcherait de dormir. »
Anne-Laure TERTOIS